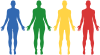L'écoumène numérique/Qu'est-ce que l'anthropologie ?
Le mot anthropologie, comme de nombreux mots et concepts utilisés en sciences humaines et sociales, est polysémique. Ce qui veut dire qu'on peut le définir de manières différentes, s’il n'est pas associé à un adjectif ou tout autre complément d’information.
Étymologiquement, le mot anthropologie se décompose en deux parties. La première, « anthropo- » est un préfixe issu du mot en grec ancien « ánthrôpos » qui se traduit par le mot « humain », tandis que la seconde : « -logie » est un suffixe qui fait référence au mot « lógos », toujours issu du grec ancien, et qui se traduit communément cette fois par le mot « discours ». D'une manière générique et lorsqu'il est utilisé de manière isolée, la définition du mot anthropologie la plus proche de ses racines étymologiques peut donc correspondre à un « discours sur l'être humain ».
Or, il faut bien reconnaître que l'on peut développer un discours sur l'humanité de nombreuses manières et en adoptant de nombreux points de vue. On peut le faire en se concentrant sur l'évolution physique et biologique du genre Homo à travers les âges, comme on le fait en anthropologie physique. On peut ensuite le faire d'une façon plus actuelle comme le fait la médecine, ou encore en se focalisant sur le psychisme à la manière des psychologues. Ceci alors que les sociologues préféreront quant à eux axer leurs discours sur l'organisation sociale des groupes humains contemporains, les économistes sur leurs organisations économiques, les politologues, sur les aspects politiques, etc.
Cependant, dans le milieu universitaire, il est très courant que le simple terme « anthropologie » soit utilisé pour parler d'anthropologie sociale et culturelle, ou autrement dit d'une discipline qui s'intéresse à l'humain sous le prisme de la culture et du social et pas seulement, précisons-le, dans une perspective contemporaine.
Afin d'étudier les aspects culturels et sociétaux des peuples humains, le chercheur en anthropologie sociale et culturelle, le socio-anthropologue comme diront certains, a pour habitude de recourir à l'ethnographie. Il s'agit là d'une pratique dont le but est de produire des observations et des analyses dans le cadre d'une participation active à la vie quotidienne des communautés étudiées. Cette méthode d'acquisition du savoir, est de fait très prisée en anthropologie et se désigne couramment par l'expression « observation participante ». Ceci alors que la discipline qui consiste à analyser et comparer les travaux ethnographiques s'appelle l'ethnologie. Elle a pour objectif de produire des théories plus générales sur l'être humain, selon une approche qui se veut plus englobante et souvent pluridisciplinaire.
Car il faut en effet tenir compte que l'ethnographie et l'observation participante sont des pratiques relativement récentes au regard du temps d'existence des êtres humains sur terre. Le terme ethnographie fut conçu en 1767 par Johann Friedrich Schöpperlin[1], alors que l'observation participante, en tant que méthode scientifique, n'aurait été expérimentée pour la première fois que lors d'un séjour de 1879 à 1884 fait par Frank Hamilton Cushing (1857-1900) au sein du peuple amérindien zuñi de Nouveau-Mexique. Suite à quoi le chercheur publia dans la revue Popular Science de l'année 1882, un article intitulé The Zuni Social, Mythic, and Religious Systems[2].
Bien avant cela et au cours de l'année 1800, Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), un philosophe reconnu à ce jour comme l'un des précurseurs de l'anthropologie moderne, avait déjà publié au sein du journal de la société des observateurs de l'homme un article qui semblait déjà faire les éloges de l'observation participante. Son texte avait pour titre : Considération à suivre dans l'observation des Peuples sauvages et dans cet écrit tout à fait remarquable pour l'époque, on pouvait y lire que : « le premier moyen pour bien connaître les Sauvages, est de devenir en quelque sorte comme l'un d'entr'eux[3] ; et c'est en apprenant leur langue qu'on deviendra leur concitoyen »[4].
Cela dit, il fallut toutefois attendre le début du 20ᵉ siècle pour que la pratique de l'observation participante devienne populaire en anthropologie sociale et culturelle. À l'origine de cet engouement, il y eut sans aucun doute le succès d'un ouvrage écrit par Bronislaw Malinowski (1884-1942) et intitulé : Les Argonautes du Pacifique Occidental[5]. Dans ce livre publié en 1922, l'anthropologue polonais expliquait en effet comment il avait, des années durant, observé et partagé le quotidien des Trobriandais de Nouvelle-Guinée dans le cadre de ses recherches anthropologiques.
Environ trois cents ans de pratique de l'ethnographie et de l'observation participante ont ainsi permis de récolter une importante quantité d'informations sur la vie sociale et culturelle des communautés humaines. Cependant, 300 ans d'analyses représentent bien peu de choses. Les plus anciens fossiles de l'espèce Homo sapiens retrouvés sur le site de Djebel Irhoud datent d'environ 300 000 ans avant notre ère[6], ce qui explique donc pourquoi certains anthropologues se sont intéressés aux travaux d'historiens, dans le but de traiter des faits qui remontent bien au-delà de la période étudiée par l'ethnographie.
Les nombreux récits d'explorateurs, de conquérants, de colonisateurs, et autres aventuriers qui auront pris la peine de décrire la vie des peuples qu'ils ont rencontrés servent alors de documents historiques très précieux dans le cadre de l'étude sociale et culturelle de l'humain en des temps plus reculés. Ce à quoi on peut aussi ajouter tous les documents produits par d'autres personnes lettrées, qui ont pris le soin de décrire leurs propres cultures. Grâce à tous ces textes et selon les sujets qu'ils traitent, on peut alors confronter les données ethnographiques contemporaines à des observations plus anciennes. Cela permet ainsi de développer une argumentation plus solide durant la création de nouvelles théories, ou même dans certain cas, remettre en question les théories existantes.
Mais à nouveau, les plus anciens écrits déchiffrés à ce jour furent retrouvés en Mésopotamie sur des tablettes en argiles datées de 3 500 ans av. J. -C[7].. Ce qui signifie donc que l'histoire, en tant que science, ne s'intéresse finalement qu'à 1 % seulement du temps d'existence de l'humain sur terre. Les 99 % restant font en effet partie de ce que l'on appelle couramment la préhistoire, soit une époque qui se termine avec l'invention de l'écriture et qui commence avec l'apparition des premières traces humaines retrouvées lors de fouilles ou suite à l'exploration de zones peu accessibles.
Ces traces sont des os, des dents ou autres restes humains ayant résisté à la dégradation par le temps, ainsi qu'un ensemble d'objets fabriqués par l'homme, que l'on appelle artefacts. Parmi ceux-ci, on retrouve une diversité pouvant aller du simple éclat de pierre à des édifices de grandes complexités, en passant par tout un ensemble d'outils fabriqués dans des matières imputrescibles.
Et c'est alors à l'archéologie que revient la tâche d'en faire la récolte, l'inventaire et l'analyse, avec pour objectif de produire des affirmations et théories sur le passé des êtres humains et sans que ce passé ne se limite à la préhistoire. Sauf qu'en absence d'observation directe et de documents écrits, on court le risque de certains biais d'interprétation en « exagérant grossièrement l'importance de l'outil et minimisant celle du savoir-faire »[8].
Puis, lorsqu'il s'agit de temps plus reculés encore, où les traces de l’existence humaine se limitent à la présence de fossiles, c'est alors à la paléoanthropologie que revient la tâche d'étudier le passé des êtres humains. Ceci avec une aide précieuse apportée par la paléogénétique au même titre que l'archéogénétique viendra secourir les archéologues.
En 2014 par exemple, un séquençage complet du génome de l'homme de Ust-Ishim, un Homo sapiens décédé il y a 45 000 ans dans une vallée de Sibérie, a permis de découvrir que cet homme était physiquement très proche de notre apparence actuelle. À tel point que selon les estimations de Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue à la Société Max-Planck pour le développement des sciences, son « visage est celui d'une personne que vous pourriez aisément croiser dans le métro ou dans la rue »[9].
Une telle découverte permet dès lors de supposer que les changements sociaux et culturels qu'a connu notre humanité depuis 45 000 ans ne sont probablement pas tant dû à des changements génétiques, mais plutôt à des changements sociaux et culturels issus de variations dans les comportements, habitudes, coutumes et du savoir transmis de générations en générations. Car il est vrai que, chez les humains, ce transfert intergénérationnel que l'on désigne communément par le mot « culture » est extrêmement développé par rapport aux autres êtres vivants.
Cette faculté serait particulièrement développée chez l'humain en raison du caractère altriciale de son cerveau, dont le développement des capacités cognitives s'effectue en grande partie après la naissance[10]. Selon les recherches sur la stabilisation sélective des neurones[11], une compétence cognitive génétiquement présente chez le nouveau né, mais qui n'est pas stimulée durant sa croissance, disparaît à jamais. Un phénomène qu'illustrent parfaitement certains enfants sauvages ou séquestrés dont les retards cognitifs sont irrécupérables[12].
Tout ceci justifie donc l'importance qu'il faut accorder à la culture et aux évolutions culturelles dans le cadre de l'étude des êtres humains. Malheureusement, si les récoltes minutieuses et abondantes d'informations produites par les ethnographes permettent d'étudier en détails les variations sociales et culturelles des peuples, on ne peut pas dire autant des textes anciens et encore moins des informations récoltées par les archéologues et paléoanthropologues.
Plus on remonte dans le temps, plus l'information devient lacunaire et insuffisante pour établir des théories inébranlables sur les changements sociaux et culturels apparus chez l'homme. Il devient alors tentant d'utiliser les travaux contemporains produits par les ethnographes et ethnologues au sujet des communautés de chasseurs-cueilleurs pour établir des analogies avec les organisations sociales et culturelles des peuples préhistoriques vivant à l'époque paléolithique, du mésolithique et du néolithique.
Une pluridisciplinarité doit alors se mettre en place pour pouvoir apporter des significations sociales et culturelles aux objets et traces récoltées par l'archéologie et la paléoanthropologie. Ceci alors qu'en contrepartie, les informations récoltées par ces disciplines ainsi que celles produites par les généticiens sont généralement plus fiables et objectives que celles obtenues par le biais d'interviews ou de comptes rendus d'observation. Les traces laissées par l'humain, y compris dans son code génétique, resteront toujours plus objectives qu'un discours rapporté, qui toujours, sera sujet à une interprétation subjective.
Produire un discours complet sur l'être humain implique donc de faire un recoupement entre de nombreux savoirs récoltés au sein de nombreuses disciplines. Ceci notamment pour éviter toute spéculation, fabulation ou falsification d'un passé dans le but de défendre ou promouvoir certaines idéologies. D'ailleurs, grâce aux nouvelles informations fournies suite au progrès de la génétique, des techniques de datation, de télédétection et autres, de nombreuses croyances sur le passé des êtres humains doivent êtres revues.
En anthropologie, comme dans toutes sciences, il faut donc toujours garder un regard critique sur les arguments et théories produites, puisque de surcroît, il ne s'agit pas d'une science exacte. Pour bien l'accomplir, il faut donc s'efforcer de produire des logiques sans faille, basées sur des observations et analyses aussi minutieuses qu'objectives, destinées à fournir les arguments qui seront mobilisés dans la production de nouvelles théories.
Mots clefs : éthymologie - diversité des approches - anthropologie sociale et culturelle - période ethnographique, historique préhistorique - pluridisciplinarité par intérêts et époques - pièges heuristiques
Références
[modifier | modifier le wikicode]- ↑ Hans Vermeulen, Early History of Ethnograph and Ethnolog in the German Enlightenment: Anthropological Discourse in Europe and Asia, 1710–1808, Leiden, Privately published, 2008
- ↑ Frank Hamilton Cushing, « The Zuni Social, Mythic, and Religious Systems », dans Popular Science Monthly Volume 21 June 1882 (lire en ligne)
- ↑ Mot retranscrit tel-quel dans son orthographe ancienne.
- ↑ Joseph-Marie de Gérando, Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages, 1800 [lire en ligne]
- ↑ Malinowski, Bronislaw, Les argonautes du Pacifique occidental, Gallimard, 1963 (OCLC 954049132)
- ↑ Jean-Jacques Hublin, Abdelouahed Ben-Ncer et al., New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens, Nature, juin 2017
- ↑ Jean-Jacques Glassner, Écrire à Sumer, l'invention du cunéiforme, Paris, Éditions du Seuil, 2000, 304 p. (ISBN 2-02-038506-6), p. 65
- ↑ Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d'abondance. L'économie des sociétés primitives, Editions Gallimard, 2017-03-16 (ISBN 978-2-07-271180-0)
- ↑ Jean-Jacques Hublin, « Une nouvelle découverte remet en cause l'évolution de l’Homo sapiens », sur National Geographic, (consulté le 6 octobre 2022)
- ↑ Joel Candau, « Altricialité », Anthropen, 2018-09-08 (ISSN 2561-5807) [texte intégral lien DOI (pages consultées le 2022-12-02)]
- ↑ Jean-Pierre Changeux, Philippe Courrége et Antoine Danchin, « A Theory of the Epigenesis of Neuronal Networks by Selective Stabilization of Synapses », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 70, no 10, 1973-10, p. 2974–2978 (ISSN 0027-8424 et ISSN 1091-6490) [lien PMID lien DOI]
- ↑ Lucienne Strivay, Enfants sauvages: approches anthropologiques, Gallimard, 2006 (ISBN 978-2-07-076762-5)