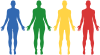L'écoumène numérique/Note d'introduction concernant les sciences humaines et sociales
Parmi les soucis majeurs des sciences humaines et sociales, réside le fait que l'expérience humaine ou sociale restera toujours une expérience unique et non reproductible à l'identique. L'étude de ces phénomènes demande de plus une approche systémique dans le sens où chaque phénomène est étroitement lié et influencé par un environnement qui ne cesse de se modifier avec le temps et dans lequel se déroule un ensemble complexe d'interactions.
Pour cette raison, Jean-Claude Passeron parle des sciences historiques et d'historicité[1], afin de démarquer les sciences sociales du concept de réfutabilité avancé par Karl Popper[2]. Car pour ce dernier, ce qui fait science, c'est la possibilité de réfuter toute affirmation, hypothèse ou théorie suite à ré-expérimentation empirique. Or, à l'exception de certaines interactions sociales bien spécifiques, comme celles pouvant être soumises à un archivage tout aussi spécifique[3], on ne peut jamais expérimenter une seconde fois l'observation d'un phénomène social d'une manière tout à fait identique.
L'analyse de ce que Émile Durkheim appelait un « fait social »[4], est effectivement toujours influencé par le contexte historique et culturel dans lequel se trouve l'observateur. Il est fort à parier en effet que deux personnes qui assistent à un fait social à des siècles différents, dans des régions et cultures différentes, ou étant soumises à des relations de pouvoir différentes, interprèteront différemment ce qu'ils observent. Ceci contrairement à l'observation d'une pomme qui tombe d'un arbre. C'est là aussi la raison pour laquelle Donna Haraway parle de connaissance située[5], une expression qui, par ailleurs, concerne tout aussi bien les sciences dures que les sciences humaines et sociales.
À cela s'ajoute ensuite la difficulté d'isoler les phénomènes sociaux et culturels les uns des autres, dans le but de réduire la quantité d'informations à traiter lors de leurs analyses. Car c'est là en effet l'une des principales faiblesses du cerveau humain que de ne pouvoir disposer d'une mémoire de travail très limitée en comparaison aux mémoires vives aujourd'hui utilisées par les ordinateurs. La mémoire à court terme d'un être humain décroit en effet de façon exponentielle avec le temps[6] et semblerait ne pas pouvoir dépasser une durée d'une minute tout en étant incapable de traiter plus de dix informations en même temps.
Grâce à la mémoire dite opérationnelle cependant, la mémoire à court terme peut être mise en relation avec le contenu de la mémoire à long terme, qui chez l'homme est considérable, mais sans pour autant être infaillible[6]. Dans le cadre de certaines pratiques assidues, il serait alors possible de construire ce que certains appellent une mémoire de travail à long terme. Cette dernière n'aurait rien de comparable toutefois, en termes de durée et de quantité d'informations en temps réel, à ce qui se passe dans les traitements informatiques aujourd'hui capables de prédire, de manière toujours plus fiable, la météo de nombreux jours à l'avance.
Pour penser la complexité du culturel et du social, l'humain a donc besoin de simplifier arbitrairement les faits réels à l'aide de différents outils méthodologiques parmi lesquels on peut citer : la catégorisation, la classification, la typologie, l'idéal-type, l'analogie, la métaphore et l'échantillonnage. Ce à quoi on peut encore ajouter dans certaines disciplines des sciences humaines et sociales, un goût prononcé pour les analyses quantitatives reposant sur des calculs et représentations statistiques et probabilistes, dans le but d’atteindre une plus grande objectivité dans l'analyse des faits sociaux et culturels. Cependant, lorsque ces analyses n'ont pas eu la chance d'être recoupées avec d'autres analyses qualitatives, de type ethnographique par exemple, celles-ci peuvent alors souffrir d'une certaine décontextualisation et déshumanisation nuisible à la production de bonnes théories.
Voici sans doute pourquoi les sciences humaines et sociales ont beaucoup de peine à produire des théories inébranlables. Tandis que les rares lois existantes ne sont en réalité que des abus de langage offrant un surcroît d'importance à une théorie qui n'a rien d'universel en soi, mais dont le succès et l'adhésion est souvent lié à un contexte idéologique particulier. La loi d'airain de l'oligarchie par exemple, selon laquelle toute organisation sociale tend vers une oligarchie, n'a effectivement rien d'un principe universel puisqu'elle ne pourrait s'appliquer, ni chez les alcooliques anonymes, ni dans de nombreuses peuplades de chasseurs-cueilleurs.
Un autre souci majeur des sciences humaines et sociales réside ensuite dans cette obligation de travailler, non pas avec des concepts aussi précis que des chiffres, des vecteurs ou des quantités de matière (mole), ni encore avec des matériaux aussi palpables qu'une pierre, un burin ou un marteau, mais bien avec des mots issus de l'imaginaire humain et dont certains souffrent d'ambivalence. Le mot « travail » est un bel exemple, puisqu'il substitue bien souvent l'usage des termes plus appropriés que sont : l'emploi, l'activité, l'étude, la pratique, etc. Lorsqu'un discours ou un débat s'établit autour de ce genre de termes polysémiques, survient alors généralement une grande incompréhension entre les interlocuteurs, lorsque ceux-ci partagent des représentations différentes d'un même concept.
Le mot « pouvoir », en tant que substantif, est un autre exemple, puisqu'il n'aura pas non plus le même sens selon qu'il se situe dans un discours philosophe (une capacité au sens large), sociologique (la faculté d'imposer sa volonté) et politique (une assemblée investie d'un pouvoir sociologique). De plus la notion de pouvoir est fréquemment confondue avec celle d'autorité, alors que la politologue et philosophe Hannah Arendt distingue les deux concepts. En effet, pour elle, et contrairement au pouvoir, l'autorité s'établit sans coercition ni persuasion, mais repose sur une reconnaissance inconditionnelle envers la personne ou l'entité qui commande[7]. Une opinion qui bien sûr lui est propre et qui de fait ne fait pas l'unanimité. Sans compter qu'en sciences humaines et sociales certains auteurs établissent leurs propres définitions sur des termes définis autrement par d'autres ou dans d'autres contextes. La définition du terme habitus utilisé par Bourdieu en sociologie est en effet différente de celle utilisée par d'autres en minéralogie, en biologie ou en médecine.
Voici donc pourquoi, dans le cadre d'une leçon produite en sciences humaines et sociales, il est toujours bon de définir préalablement les principaux termes que l'on compte employer. Alors qu'avant cela, il est aussi toujours bon de définir précisément la science ou la discipline dans laquelle s'inscrit le discours que l'on souhaite transmettre.
Mot clefs : systémique - historicité - connaissance située - mémoire de travail & méthodes - abus de langage - absence de signifié & polysémie - pouvoir & autorité.
Notes et références
[modifier | modifier le wikicode]- ↑ Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique: un espace non poppérien de l'argumentaton, Albin Michel, 2006 (ISBN 978-2-226-15889-5)
- ↑ Karl R Popper, Conjectures and refutations the growth of scientific knowledge., Routledge & Kegan Paul, 1963 (OCLC 1070438148)
- ↑ Lionel Scheepmans, « Imagine un monde : quand le mouvement Wikimédia nous aide à penser de manière prospective la société globale et numérique de demain », Dial, UCL - Université Catholique de Louvain, 2022, p. 332 [texte intégral] Voir spécifiquement la section intitulée « Une écriture authentifiable au service d'une lecture immersive ».
- ↑ Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, F. Alcan, 1895 [lire en ligne], p. 181
- ↑ Donna Haraway, « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies, vol. 14, no 3, 1988, p. 575–599 (ISSN 0046-3663) [lien DOI]
- ↑ 6,0 et 6,1 Nadia Auriat, Les défaillances de la mémoire humaine: aspects cognitifs des enquêtes rétrospectives, INED, 1996 (ISBN 978-2-7332-0136-7) [lire en ligne]
- ↑ Yves Sintomer, « Pouvoir et autorité chez Hannah Arendt », L'Homme et la société, vol. 113, no 3, 1994, p. 117–131 [texte intégral lien DOI]